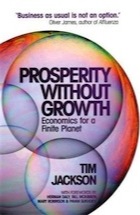Il semble vaguement se dégager, parmi les intellectuels, hommes politiques de tous bords, artistes, entrepreneurs, activistes et autres citoyens du mouvement dit écologiste, une ligne commune des principes économiques, sociaux, et psychologiques à défendre pour le siècle à venir. Extrait.
La climatologie apporte des éléments qui nous forcent à plus ou moins tout repenser ; l’homme est heureusement inventif, mais on ne peut pas simplement espérer que la science règle tout ; climat ou pas, de toute façon notre économie consiste avant tout à transformer des ressources naturelles, et sa croissance atteint ses limites physiques ; les indicateurs économiques et sociaux de référence (le PIB en premier lieu) n’ont que peu d’intérêt dans toute cette histoire, alors qu’on parvient à mesurer assez précisément ce qui est vraiment pertinent ; l’investissement est généralement trop focalisé sur la rentabilité, et ce à court terme ; il faut investir massivement dans les énergies décarbonées et les économies d’énergie ; il faut découpler au maximum l’économie des ressources naturelles en développant l’économie circulaire, l’économie de fonctionnalité, et les services à la personne… ainsi qu’en prolongeant la durée de vie des produits ; il faut revoir la fiscalité et la réglementation pour inciter les agents à aller dans « la bonne direction », en commençant par taxer l’énergie et la pollution plutôt que le travail ; au-delà d’un certain seuil (dépassé depuis longtemps en Occident), le bien matériel contribue assez marginalement, voire négativement, au bien-être de l’homme.
On a parfois l’impression d’enfoncer des portes ouvertes, mais tout cela n’est pas neutre. Quand on parle, par exemple, de prolonger la durée de vie des produits, ça implique de réduire d’autant l’activité industrielle, et de trouver de nouvelles logiques commerciales.
Au final, pour quantifier un peu tout ça, une grande partie du débat consiste à équilibrer l’équation du siècle, a.k.a l’équation de Kaya :
Mathématiquement parlant, le degré de polémique est plutôt limité. On divise puis on multiplie CO2 par les mêmes grandeurs. Ca permet d’établir un lien entre émissions de gaz à effet de serre (tous les gaz sont rapportés en tonnes équivalent CO2), consommation d’énergie (toutes les formes d’énergie sont rapportées en TEP, tonnes équivalent pétrole), taille de l’économie (PIB), et population (Pop).
Jean-Marc Jancovici détaille plusieurs hypothèses sur la façon d’équilibrer cette équation. En résumé, il s’agit, dans les 50 ans à venir, de diviser par 2 (un facteur 4 ne serait pas un luxe pour assurer nos arrières) la partie de gauche de l’équation et se sortir du pétrin. Or il est prévu que Pop passe de 6 à 9 milliards d’habitants, soit une partie de droite multipliée par 1,5. On aimerait beaucoup, par ailleurs, que le revenu par habitant (PIB/Pop) soit multiplié par 3, à supposer que cela soit possible malgré des ressources naturelles de plus en plus chères. La théorie économique conventionnelle n’intègre pas ce type d’enjeu, mais peu importe.
Ainsi la partie droite de l’équation est multipliée par 4,5, et on souhaite diviser celle de gauche par 2, les choses sont plutôt mal engagées. Il faut ainsi, pour trouver l’équilibre, que :
(CO2 / TEP) x (TEP / PIB) soit divisé par 9 (voire plutôt 18 si on veut diviser CO2 par 4).
En français, ça veut dire que l’intensité carbone de l’énergie (CO2/TEP) et l’efficacité énergétique de l’économie (TEP/PIB) doivent réaliser des progrès considérables. Le premier terme en développant les énergies décarbonées, le second terme en faisant tourner l’économie plus efficacement.
Toute réflexion sur le sujet se heurte tôt ou tard au « dilemme de la croissance », auquel personne n’a véritablement trouvé de solution qui fédère suffisamment de monde, ne serait-ce parmi les écologistes. Les gains d’efficacité seront-ils suffisants pour rendre la croissance écologiquement stable ? Si non, est-il possible de rendre la décroissance économiquement et socialement stable ?
C’est ce dilemme qu’essaie de résoudre Tim Jackson dans Prospérité sans Croissance, paru en 2010, et qui fait référence en la matière. Jackson reprend les grands principes énoncés plus haut (il esquive, au passage, la question de la démographie, sur laquelle les écologistes sont partagés). Pour aller plus loin, il se positionne sur quelques autres idées, parfois déjà évoquées par d’autres.
Tout d’abord, le découplage absolu entre économie et émissions de CO2 est un mythe. Un découplage relatif peut effectivement être observé (le progrès permet de polluer moins à production constante), cependant la croissance de la production fait qu’au final, on pollue plus. Il faudrait d’ailleurs que (CO2 / TEP) x (TEP / PIB) soit divisé par un facteur 150 pour que le monde entier puisse vivre « à l’Occidentale ». C’est impossible, donc il faut trouver un autre modèle.
Il reste indispensable, bien entendu, d’aller chercher ces gains d’efficacité, mais en se mettant sérieusement en mode économie de guerre, comme en 39-45 où les dépenses militaires des Etats-Unis sont passées de 2% du PIB à plus de 50% (grosso modo, we get the gist) du jour au lendemain. Mais l’investissement est aujourd’hui un sérieux goulet d’étranglement dans la transition à opérer : une revue des différents plans de relance 2008-2009 révèle des parts largement insuffisantes investies dans ce qui pourrait ressembler, de près ou de loin, à une économie « verte » (Corée du Sud mise à part, et encore).
Qu’est-ce qu’il nous faut pour être heureux ? Jackson rapporte une série de graphes croisant, pays par pays, le PIB avec l’espérance de vie, le PIB avec le niveau d’éducation, le PIB avec la proportion des gens se déclarant « heureux »… Il se trouve qu’au-delà du PIB de pays comme le Chili ou le Costa Rica ($ 12 000 par habitant, tandis que celui des Etats-Unis dépasse les $ 40 000), on atteint un plateau. Au-delà de $ 12 000, les indicateurs de bien-être varient autour de ce plateau : il y a donc quelque chose d’autre que le PIB en jeu.
Mais alors il faut bien se demander pourquoi on poursuit avec frénésie l’accumulation de biens. Il n’est pas simplement question de se faire plaisir. La théorie avancée est que ces biens sont devenus indispensables pour participer à la vie en société, pour communiquer avec autrui. « Si j’ai pas d’ordi ça va être la honte à l’école », « T’as vu Pierre et Marie vont au Brésil cet été, c’est une destination à la mode », « Ah ton portable il fait pas ça ? », etc. C’est la menace d’isolement qui régit le consumérisme moderne. Les décroissants disent souvent être tiraillés entre leur souci de consommation durable et les contraintes sociales imposées par leur cadre professionnel, familial, et communautaire. Il faut donc trouver de nouveaux modes d’interaction pour exister socialement et créer des liens de communauté. Les possibilités sont nombreuses, y compris celles piochées dans la culture occidentale, mais le défi consiste à sortir, en premier lieu, du piège consumériste. Les médias, l’éducation, les incitations fiscales, entre autres, ont un rôle important à jouer.
Mais la contribution la plus notable de Prospérité sans Croissance réside dans ce qui pourrait constituer un nouveau modèle macroéconomique, qui résolve le dilemme de la croissance. Quelques extraits de ce nouveau modèle (comment résister ici aux bulletpoints de consultant ?) :
- Toute croissance à venir du PIB doit être tirée par l’investissement (sur le long terme), plutôt que la consommation, qui intègre plus difficilement l’impératif écologique. Différentes cibles de rendements sont à élaborer selon l’objectif visé et l’horizon de temps (le modèle existant dit que plus le rendement est élevé et rapide, mieux c’est, peu importe si dans l’histoire on a construit un avion de chasse ou un hôpital)
- PIB = Nombre d’heures travaillées x Productivité horaire des travailleurs
o Pour que le modèle classique de croissance infinie survive, il faut augmenter ad vitam aeternam (merci wiktionnaire) la productivité horaire des travailleurs. Il y aura alors besoin de moins de monde pour produire autant. Pour garder le plein emploi, il faut alors que l’économie crée de nouveaux secteurs d’activité, qu’elle innove constamment, qu’elle génère de nouveaux besoins, bref qu’elle croisse. Et vite.
o Le nouveau modèle propose une croissance du PIB molle, voire zéro, du moins pour les pays déjà développés. Les secteurs d’activité intenses en main d’œuvre et peu polluants (services à la personne, culture, certains loisirs, préservation des écosystèmes, économie solidaire, …) seraient privilégiés. Or il s’agit ici de secteurs formidablement improductifs, qui intéressent peu d’investisseurs. Ils permettent néanmoins, à PIB constant, de réduire la productivité et d’augmenter ainsi le besoin en heures travaillées, et donc en emplois.
o Une croissance molle suppose, une fois la productivité établie à un niveau faible, une stabilisation du nombre d’heures travaillées. Pour garder le plein emploi, il s’agira donc de partager le gâteau et réduire le temps de travail.
L’ouvrage de Jackson est un pas dans la bonne direction, mais il demeure de nombreuses questions avant de considérer qu’on a bâti une théorie générale de l’économie écologique progressiste :
- L’expérience des 35h en France est balayée rapidement, sans évoquer les problèmes que cela a engendré (organisation des horaires, stagnation des salaires, …).
- Le modèle implique forcément (ou alors je n’ai rien compris), que les travailleurs seront satisfaits de gagner moins et vivre avec moins. OK, mettons. Une baisse de pouvoir d’achat est de toute façon souvent perçue comme inéluctable pour des raisons physiques. Cependant, pour stimuler l’emploi, resterait -il possible de soutenir la demande pour les secteurs d’activité intenses en main d’œuvre, peu polluants, et improductifs, comme ceux cités plus hauts ?
A suivre certainement…
C.F. - Février 2011